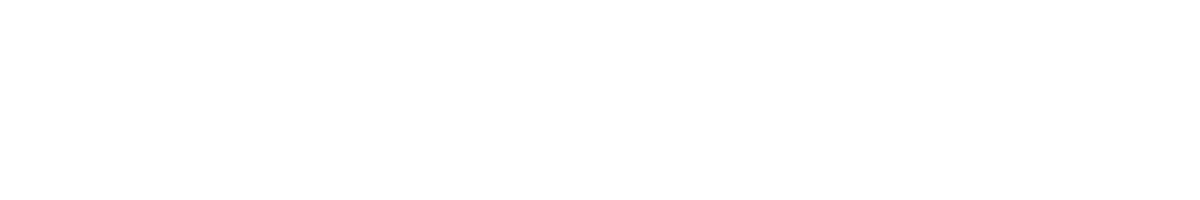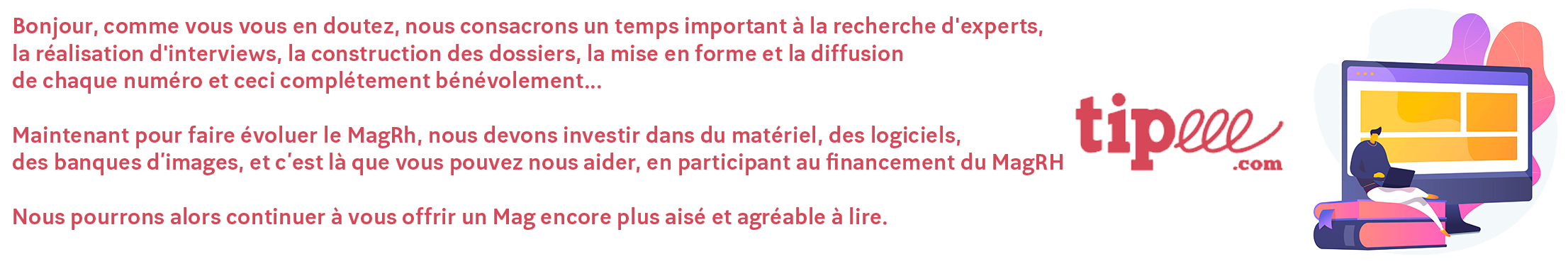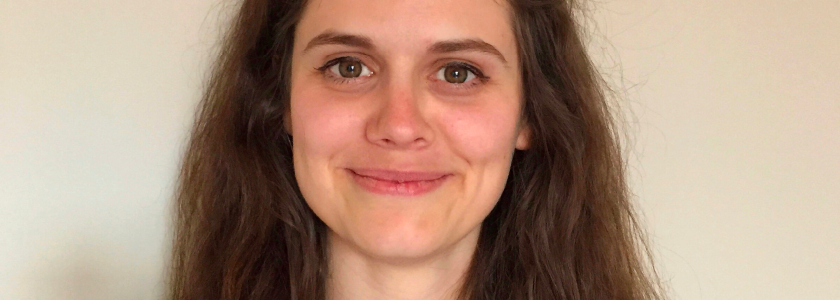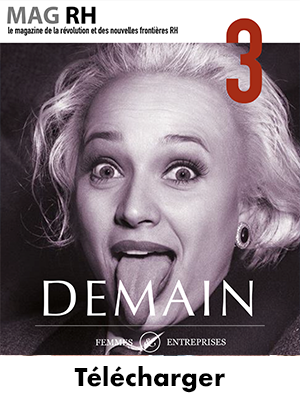Olivier MÉRIAUX (consultant, cabinet Plein Sens, ancien directeur technique et scientifique de l’ANACT) et Jean-Christophe MICHEL (consultant, cabinet Plein Sens)
Il est aujourd’hui de bon ton d’ironiser sur le babyfoot ou l’heure de yoga offerte par l’employeur en guise de « politique QVT », et nous-mêmes nous en privons rarement. Mais tirer sur l’ambulance Chief Happiness Officer témoigne aussi d’une certaine paresse intellectuelle si l’on ne cherche pas à comprendre pourquoi cette version de la QVT séduit davantage que la version symbolisée par l’accord interprofessionnel de 2013.
Alors que le discours managérial en vogue porte au pinacle l’innovation collaborative, le participatif à tous les étages et les « organisations responsabilisantes », comment expliquer que la plupart des entreprises en restent, dans la pratique, à une conception « maternaliste » de la QVT, quand elles ne sont pas dans un simple habillage de leurs obligations en matière de prévention des risques psychosociaux ?
Pour expliquer ce paradoxe apparent, il faut revenir à ce qui distingue fondamentalement l’approche de l’ANI de 2013 de ses différents ersatz : la volonté de redonner du pouvoir décisionnel au collectif de travail en le faisant s’exprimer sur ce qu’il faut transformer dans les modes d’organisation afin de mieux travailler. Or comme on le sait depuis Albert Hirschman, l’option de la prise de parole comme moyen de lutter contre la défection (le désengagement, la résignation) est une aventure essentiellement politique (Hirschman, 1970). Mettre en discussion les conditions du travail (du « bon travail », du travail efficace) est à la fois un moyen très puissant d’activer des potentiels de performance insoupçonnés et une entreprise à très haut risque pour l’équilibre des pouvoirs dans l’organisation.
Notre expérience de praticiens de l’accompagnement des entreprises tend à montrer que cette dimension politique est intuitivement identifiée par les parties-prenantes comme un facteur de risque, et à juste titre. Elle reste pourtant peu explicitée par les promoteurs d’une « vraie » QVT et peu traitée par les méthodes standard d’accompagnement. Ceci explique pour beaucoup la tendance à privilégier des approches « cosmétiques » malgré leurs limites pourtant connues (moins de risques, moins de gains) et milite pour une meilleure inclusion des problématiques de pilotage de la performance et d’exercice du pouvoir dans les démarches de QVT.
L’ambition contrariée de l’ANI de 2013
A la fois modeste dans son intitulé, confus dans sa forme et d’une ambition extraordinaire sur le fond, l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » était porteur d’un double objectif de rénovation :
- Du modèle classique de la prévention des risques professionnels, en formulant le pari de la possibilité d’une amélioration conjointe des conditions de travail et de la compétitivité des entreprises dans un contexte dynamique de transformations et de mutations. Ainsi que le souligne le directeur général de l’ANACT à l’époque, « les négociateurs n’ont pas sombré dans le piège du bonheur en entreprise. Ils invitent plutôt à revenir à des fondamentaux du management. De ce point de vue, l’accord constitue non pas un substitut aux RPS mais l’étape qui leur succède, une approche qui au-delà de l’exposition à des risques, explore les ressorts du développement de l’individu au travail » (Lanouzière, 2013).
- Du modèle de régulation sociale associé : plutôt que de donner de nouveaux droits ou d’édicter de nouvelles normes, l’ANI préconise d’expérimenter de nouvelles manières de travailler en s’adaptant aux enjeux locaux des entreprises. Pour y aider, il propose une approche systémique qui vise le décloisonnement des différents domaines (santé-sécurité au travail, développement professionnel, organisation du travail, performance...), l’articulation « à la carte » des thèmes de la négociation collective, ainsi qu’une panoplie d’outils et méthodes (formation, indicateurs, démarches participatives, expression des salariés...) pour transformer la pratique des relations sociales bien plus que son cadre juridique formel.
Six ans après sa signature, force est de constater que la conception ambitieuse portée par les promoteurs de l’ANI de 2013 semble avoir largement perdu la partie face aux divers succédanés qui circulent aujourd’hui sous le pavillon de complaisance de la « Qualité de Vie au Travail ». Il suffit pour s’en convaincre de collecter les offres commerciales étiquetées « QVT » qui s’adressent aux entreprises : la très grande majorité de celles-ci vise le développement personnel, des services individuels aux salariés (plutôt cadres du tertiaire qu’opérateurs de production), l’amélioration du confort ou de « l’ambiance » au travail.
La norme marchande de la QVT en passe de s’imposer est ainsi plus tournée vers des solutions « sur étagère » visant le bien-être des personnes dans une logique d’adaptation plutôt que l’état de l’organisation. Le « marché de la QVT » témoigne d’un « air du temps » très en vogue, que les politiques RH ne font pour l’essentiel qu’accompagner. Mais elle signe aussi l’absence persistante d’un agenda stratégique centré sur les nouvelles organisations à inventer pour répondre aux conditions d’une performance globale et durable du point de vue des ressources humaines.
« Aussitôt signé, aussitôt oublié » notait un observateur lapidaire six mois après la signature de l’ANI QVT (Richer, 2014). Six ans après, l’état des lieux de la dynamique conventionnelle est à peine plus encourageant. Sur le plan quantitatif d’abord, surtout si l’on met de côté les quelques dizaines d’accords signés par les grands groupes usual suspects de l’innovation sociale. Mais également sur le plan qualitatif, tant il est évident que le dialogue social en entreprise a surtout investi les aspects « sociétaux » les plus facilement consensuels (articulation des temps, diversité, handicap...) au détriment des questions de performance (Anact, 2019).
Le Législateur n’est ici pas tout à fait hors de cause, qui avec la loi El-Khomry et les Ordonnances Travail a fait rentrer dans le Code du Travail (article L2242-17, dispositions supplétives) une obligation annuelle de négocier sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail version « cases à cocher » : articulation vie personne/vie professionnelle + égalité professionnelle + lutte contre les discriminations + insertion des handicapés + droit d’expression directe et collective des salariés + droit à la déconnexion. Ce faisant, non seulement la vision expérimentale et systémique prônée par l’ANI a été effacée, mais le centre de gravité de la négociation d’entreprise sur la QVT a été déplacé du sujet des conditions d’un travail de qualité et efficace vers la moralisation de l’employeur « responsable ».
L’expression directe des salariés sur les conditions de leur travail, « banc d’essai » pour une vision ambitieuse de la QVT
Il est de notre point de vue très significatif que le droit d’expression ne figure plus que comme un sujet parmi d’autres dans cet article du Code du Travail. Car c’est bien la place laissée à l’expression directe des salariés sur les conditions de leur travail qui fait l’embranchement entre les démarches QVT cosmétiques — celles dont la pente à dégénérer aboutira à la mise en place d’un CHO ou à la prise en charge de leçons de méditation de pleine conscience à l’heure du déjeuner — et celles qui relèvent d’une ambition transformatrice plus franche, et surtout plus en prise sur les conditions organisationnelles de l’efficacité collective.
Or sur ce plan également, l’ANI n’a pas réellement créé de dynamique : un sondage réalisé en 2015 pour l’Anact1 montrait que moins de 15% des salariés déclaraient avoir participé à un « espace de discussion » sur le travail, estimation qui parait optimiste si l’on se fie à un repérage empirique des initiatives et des accords d’entreprise sur le droit d’expression. En-dehors de quelques cas d’expérimentations emblématiques au sein de grands groupes ayant fait l’objet d’investigations approfondies (Merceron, 2016 ; Bonnefond, 2016) et d’une large communication, très peu d’évaluations indépendantes ont été produites pour en mesurer les effets induits et les conditions de réussite.
Reconnaissons que l’ANI de 2013 n’était pas d’une très grande clarté. Son article 12 proposait un subtil — trop subtil ? — équilibre entre la réaffirmation du pouvoir d’organisation de l’employeur et la volonté syndicale de redynamiser le droit d’expression : « si l’organisation du travail est de la seule responsabilité de l’employeur, la possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail, est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail ». Mais au-delà du flou des principes, l’accord de 2013 avait le mérite de suggérer un modus operandi minimal pour mettre en place et faire vivre des « espaces de discussion » : « (ils) s’organiseront sous la forme de groupes de travail entre salariés d’une entité homogène de production ou de réalisation d’un service. Ils peuvent s’organiser en présence d’un référent métier ou d’un facilitateur chargé d’animer le groupe et d’en restituer l’expression et comportent un temps en présence de leur hiérarchie ».
Discuter du travail, exigences méthodologiques et portée politique
Les grands principes méthodologiques présents dans l’ANI de 2013 prétendaient tirer les enseignements de l’essoufflement des initiatives issues des Lois Auroux. Dès avant la signature de l’accord, des experts et des universitaires en pointe sur le sujet (Ughetto, 2007 ; Detchessahar, 2011, 2013) livrent des recommandations opérationnelles pour mettre en œuvre les espaces de discussion. L’ANACT, qui a alimenté abondamment les travaux des partenaires sociaux, produit et diffuse dans la foulée de nombreux outils, éprouvés dans des démarches-pilotes, pour « équiper » les entreprises désireuses de se lancer dans l’aventure des espaces de discussion (Anact, 2016). L’ingénierie de la discussion du travail devient un sujet en soi, notamment pour les ergonomes qui peuvent mobiliser toutes les ressources méthodologiques de leur discipline pour « faire parler l’activité » (Rocha 2014 ; Van Belleghem, Forcioli-Conti, 2015).
Sur le plan de la méthode, « coller au travail réel » en donnant aux parties-prenantes une capacité à analyser les activités de travail semble effectivement la meilleure manière de limiter les dérives des espaces de discussion : « si vous allez trop vers les produits et les prestations, vous recréez les défunts cercles de qualité ou pire, vous faites du ‘lean management’ mal compris, qui aboutit à étouffer les espaces de parole des salariés ; si vous allez trop vers des sujets économiques, vous dérivez vers le débat lié à la stratégie et à la culture d’entreprise ; si vous allez trop vers des sujets individuels, vous empiétez sur les entretiens annuels et la relation managériale (Richer, 2013).
Notre propre expérience de l’accompagnement de grandes entreprises dans la mise en place de démarches de mise en discussion des organisations de travail — parfois à très grande échelle — confirme toute l’importance de l’équipement méthodologique des parties prenantes et l’intérêt dans cette perspective de pouvoir mobiliser la boite à outils de l’analyse de l’activité (Domette, Michel, 2016). C’est notamment la raison pour laquelle ces démarches débutent par une phase de transfert aux parties prenantes de repères méthodologiques communs pour conduire ensemble des observations sur le travail réel. L’encadrement de proximité doit également être soutenu afin d’être en capacité de faire émerger des collectifs les situations de travail sur lesquelles ils souhaitent travailler. L’acquisition de techniques d’animation est indispensable pour limiter l’effet « double casquette » qui frappe les managers invités à adopter un « positionnement participatif » au cours des espaces de discussion, en contradiction par rapport à un positionnement plus descendant attendu le reste du temps.
Mais ces conditions techniques ne doivent pas occulter la dimension fondamentalement politique de la mise en discussion du travail (Ughetto, 2014), « au sens où elle est le moyen d’une finalité qui est de produire des solutions ou des règles » (Detchessahar, 2019). Cette formulation abstraite a des implications très concrètes pour ceux qui s’essayent à déployer ces démarches : une fois outillés sur le plan méthodologique, les espaces de discussion réussiront ou échoueront en fonction de rapports de force et de processus décisionnels qui se situent bien au-dessus du niveau auquel se situe la discussion.
Pour cette raison, il est impératif non seulement que la discussion s’engage en présence de l’autorité (cf. en ce sens Detchessahar, 2019) mais surtout qu’elle permette à ceux qui l’incarnent de renforcer leur propre capacité à obtenir de l’organisation « d’en haut » des marges de manœuvre suffisantes pour solutionner ce qui émane de la mise en discussion du travail. Il s’agit idéalement de mettre en place une « subsidiarité remontante » dans laquelle les « niveaux inférieurs suggèrent aux niveaux supérieurs les actions qu’ils pourraient engager et les décisions qu’ils devraient prendre » (Van Belleghem, Forcioli-Conti, 2015).
Cette orientation problem solving rapproche les espaces de discussion des démarches d’amélioration continue (Kaizen) déployées dans le cadre du lean manufacturing. De ce point de vue, les retours d’expérience dont nous disposons montrent que la diffusion des principes du lean dans les dernières décennies a pu avoir des effets ambivalents sur la compréhension de la QVT par les salariés. D’un côté le déploiement du Kaizen et des équipes autonomes permet l’acculturation aux pratiques de dialogue professionnel orientées vers l’efficacité productive et joue, jusqu’à un certain point, comme un facteur de légitimation : la rigueur des méthodes à l’œuvre permet de produire des réponses là où le droit d’expression version Lois Auroux avait tendance à verser dans la caricature faites par ses détracteurs: « dites moi de quoi vous avez besoin pour bien travailler, je vous dirais comment vous en passer ».
Mais dans le même temps, le dialogue professionnel à la sauce Kaizen tend à limiter la portée de la discussion aux déterminants immédiats de l’efficacité, aux « quick wins ». Or une fois ceux-ci épuisés, d’autres sujets émergent, qui tendent à élargir les problèmes à résoudre et qui imposent de remonter parfois très haut dans les chaines de décision pour produire des réponses : le mode de fixation des objectifs de production, la conception même des produits, la qualité du service rendu. Dans l’une des entreprises (un important bailleur social) que nous avons accompagnée pour mettre en place un nouveau schéma d’organisation en équipes autonomes, l’exercice de co-construction a ainsi conduit à réinterroger les modalités de pilotage et de gouvernance des agences locales, la capacité des responsables territoriaux à adapter la stratégie du groupe aux caractéristiques du territoire — et donc la pertinence d’une stratégie « unique » — mais également les sujets sensibles de la rémunération ou de la maîtrise des gestes métiers nécessaires à un fonctionnement plus autonome.
C’est généralement à ce stade que le soufflé retombe si l’entreprise, au plus haut niveau de sa gouvernance, n’assume pas l’élargissement de la discussion dans la perspective d’en retirer des gains encore supérieurs en termes de transformation de la culture managériale. S’assurer d’un portage fort de l’ensemble du top management est indispensable pour inscrire ces espaces dans l’organisation du travail et à tous les niveaux hiérarchiques, selon une logique de subsidiarité.
C’est aussi à ce stade que la réinscription du dialogue professionnel au sein d’un dialogue social qui va s’en trouver régénéré s’avère indispensable pour redéfinir les termes politiques du « pacte social et économique » qui surplombe les discussions sur le travail : quels sont les engagements réciproques qui permettent de sécuriser dans la durée les nouvelles organisations du travail ? Quels sont les paramètres « business » (volume d’activité, investissements, gammes de produits) que les représentants de l’actionnaire doivent garantir en contrepartie des nouvelles exigences (d’organisation du temps de travail, d’évolution des métiers) acceptées par les collectifs de travail par la voie de leurs représentants ?
Les « pactes d’avenir » conclus dans certains sites du groupe Michelin en parallèle d’une démarche de management autonome de la performance sont exemplaires de cette trajectoire de réinscription du dialogue sur les organisations responsabilisantes dans un horizon stratégique partagé avec les partenaires sociaux. De notre point de vue d’accompagnateur de ces démarches, c’est précisément parce qu’elle assume les risques de la dimension politique du dialogue sur les conditions structurelles d’un travail de qualité que la démarche « performe » : « La possibilité de découvrir ce que personne ne soupçonnait jusque-là, où se niche finalement le secret de la performance durable, dépend de la dose de vérité qu’une organisation est capable de supporter ; du temps qu’elle investit aussi pour produire cet oxygène dialogique dont dépend de plus en plus la performance » (Clôt, 2019).
Conclusion
De « Qualité de Vie au Travail » il n’est plus vraiment question à ce stade et c’est heureux car c’est sans doute ce qui nous prémunit de retomber dans les ornières du maternalisme des salariés et de la responsabilisation de « l’employeur social ». Pour les entreprises soucieuses de la durabilité de leur performance, le sujet central est d’améliorer la qualité du travail et des conditions dans lesquelles il se réalise (plutôt que la « QVT »). Comme l’ont montré de nombreuses études sur les pratiques des entreprises durablement performantes (cf. la recension dans Bourdu, Pereti, Richer, 2016), donner corps à l’exigence de « prise de parole » des individus sur leur travail est une réponse à l’évolution des aspirations individuelles, tout autant qu’une condition pour maintenir des atouts concurrentiels immatériels (l’engagement, la motivation, la prise d’initiatives) dans le nouvel environnement économique.
Mais le sujet dépasse de loin la sphère économique et le « sujet entreprise », dans une période ou revient violemment sur le devant de la scène politique la question des insuffisances de la démocratie représentative et des formes d’association des citoyens aux décisions collectives. A de rares exceptions près (Rayssac, Kaisergruber, Richer 2019), peu de voix se font entendre pour rappeler que la crise de l’autorité institutionnelle frappe aussi l’entreprise et que la désaffection est tout aussi forte entre le salarié et l’entreprise (surtout quand elle est grande et « anonyme »)2 qu’entre le citoyen et les instances politiques. Cette dimension civique du développement du dialogue sur le travail devrait être considérée comme constitutive de la responsabilité de l’entreprise. Mais pour l’heure sa prise en compte dans les politiques managériales et les pratiques RH reste bien en-deça de l’importance qu’il revêt pour nos fragiles démocraties libérales.
Bibliographie :
- Anact, 2016, 10 questions sur la qualité de vie au travail. https://www.anact.fr/file/2866/download?token=51Qt_Jb0
- Anact, 2019, Un cap à tenir - Analyse de la dynamique de l’ANI Qualité de vie au Travail – Egalité professionnelle du 19 juin 2013, rapport février 2019, https://www.anact.fr/file/8738/download?token=bdFLGWl8
- Bonnefond (JY), 2016, L’intervention dans l’organisation en clinique de l’activité : le dispositif ”DQT” Renault à l’usine de Flins. Thèse de doctorat du Conservatoire national des arts et métiers
- Bourdu (E.), Péretie (MM) Richer (R.), 2016, La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les organisations du travail, Paris, Presses des Mines
- Clot (Y.), 2019 « Dialoguer pour faire autorité », in Detchessahar (M.) (coord.), 2019, L’entreprise délibérée : Refonder le management par le dialogue, Ed. Nouvelle Cité
- Detchessahar (M.) (coord.), 2019, L’entreprise délibérée : Refonder le management par le dialogue, Ed. Nouvelle Cité
- Detchessahar (M.), 2001, « Quand discuter, c’est produire... Pour une théorie de l’espace de discussion en situation de gestion », Revue française de gestion. N°132, p. 32-43.
- Detchessahar (M.), 2011, « Santé au travail. Quand le management n’est pas le problème, mais la solution… » Revue française de gestion. N° 214, p. 89-105.
- Detchessahar (M.), 2013, « Faire face aux risques psychosociaux : quelques éléments d’un management par la discussion ». Négociations, N° 19, p.57-80.
- Forcioli-Conti (E.), Van Belleghem (L), 2015, « Une ingénierie de la discussion ? Chiche ! », communication au 50ème congrès de la SELF
- Kaisergruber (D). Rayssac (GL), Richer (M.) 2019, Délibérer en politique, participer au travail : répondre à la crise démocratique », Rapport pour la Fondation Terra Nova.
- Lanouzière (H.), 2013, « Un coup pour rien ou un tournant décisif ? », Semaine sociale Lamy, 16 septembre 2013, n°1597
- Merceron (JY), 2016, Principe de subsidiarité et management des organisations. Possibilités, conditions et limites d’un management subsidiaire : le cas d’une banque régionale, Thèse de doctorat de l’Université de Nantes.
- Richer (M.), 2013, « L’expression des salariés, 7 bonnes pratiques pour réussir, « http://management-rse.com/2013/12/17/lexpression-des-salaries-au-travail-7-bonnes-pratiques-pour-reussir/
- Richer (M.), 2014, « Qualité de vie au travail, le vilain petit accord ? » https://management-rse.com/2014/01/14/qualite-de-vie-au-travail-le-vilain-petit-accord/
- Rocha (R.), 2014, Du silence organisationnel au développement du débat structuré sur le travail : les effets sur la sécurité et sur l’organisation. Thèse de doctorat en ergonomie, Université de Bordeaux. Bordeaux, France.
- Ughetto (P.), 2007, « Faire face aux exigences du travail contemporain. Conditions du travail et management ». Editions de l’ANACT.
- Ughetto (P.), 2014, « L’espace politique des espaces de discussion sur le travail », ⟨hal-01089705⟩