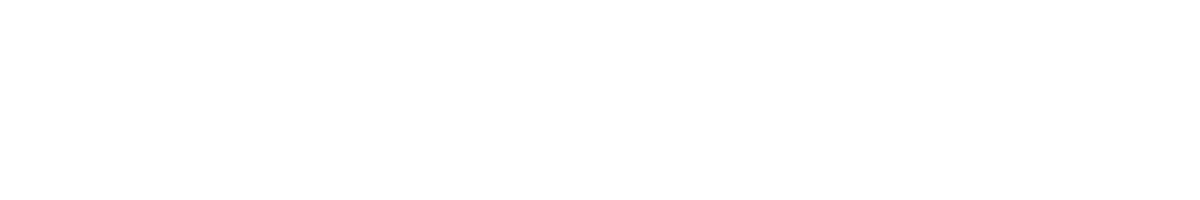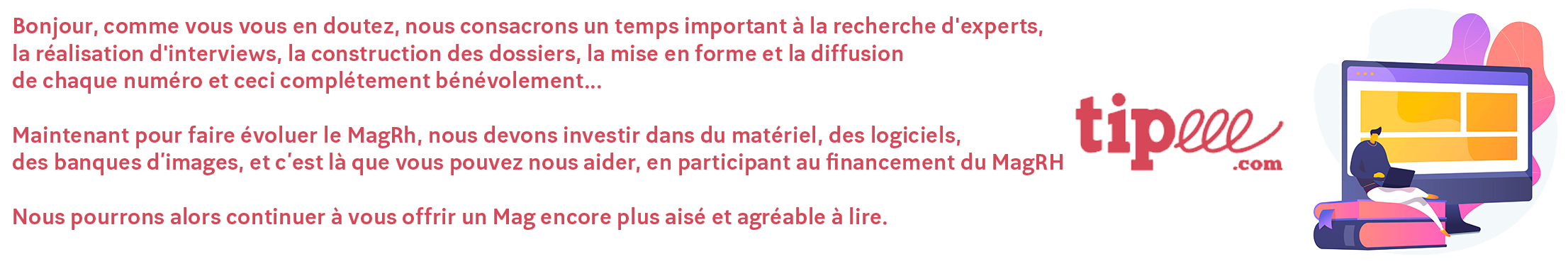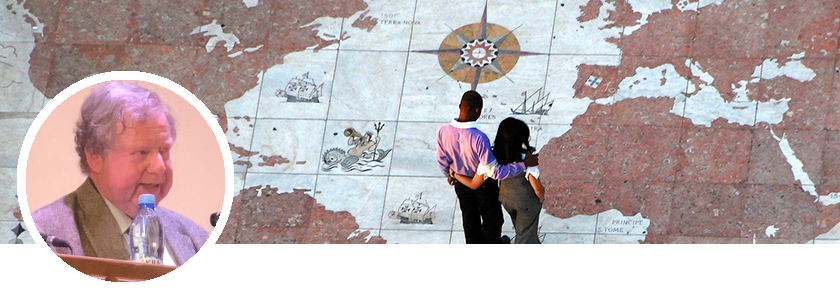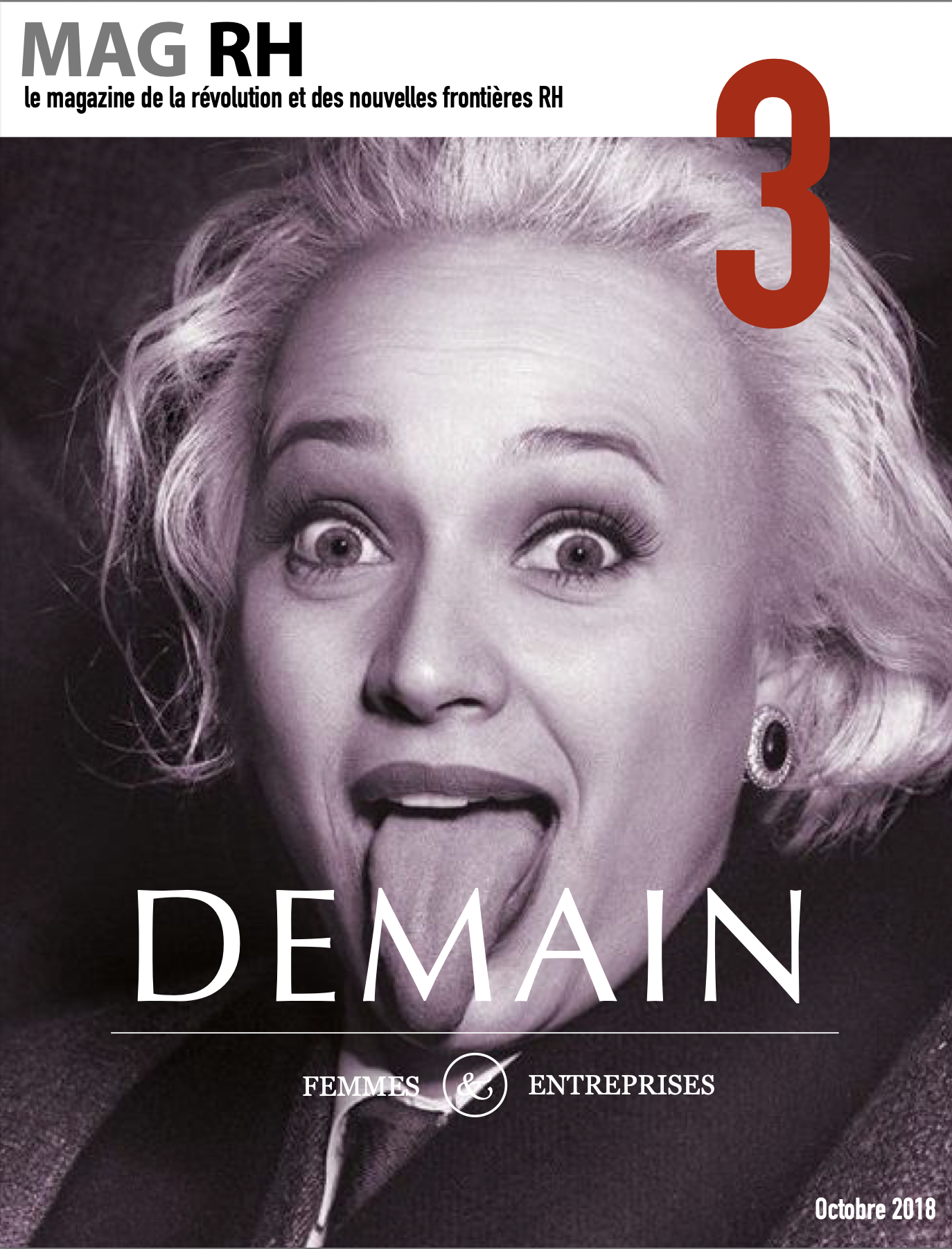Denis Monneuse, Enseignant-chercheur, directeur du cabinet de conseil « Poil à Gratter
Les réunions de travail, c’est comme les relations sexuelles : on s’en souvient rarement en détail quelques jours après, mais celles dont on se souvient restent en revanche gravées dans notre mémoire à jamais.
Parmi celles dont je me souviens (les réunions de travail, pas les relations sexuelles !), il y a les cinq suivantes que je voudrais partager avec vous car elles ont contribué à forger mon regard sur la RSE. En deux mots : la RSE devrait être la cerise sur le gâteau, la nouvelle lubie d’une entreprise une fois qu’elle fonctionne parfaitement. Or l’expérience montre que les organisations mettent la charrue avant les bœufs : elles se délectent de responsabilité sociale, voire sociétale, alors qu’elles parviennent à peine à respecter les lois.
Je développe ici une approche critique et constructive en proposant un positionnement plus humble de la RSE comme aiguillon et direction opérationnelle au service des autres départements de l’entreprise1.
La RSE ou l’arbre qui cache la forêt
La première réunion que je ne suis pas prêt d’oublier se déroula dans une multinationale du secteur de l’industrie. Jeune consultant, je dois faire une présentation à la fin du Codir RH-RSE. Quand j’arrive, le DRH présente le bilan social du groupe. Il dit quelques mots sur l’absentéisme maladie pour indiquer qu’il faudrait le réduire ‒ comme s’il suffisait de le dire pour le faire ! ‒ puis passe aux accidents de travail. Il y eut plusieurs accidents de travail mortels dans l’année. Pas en France, mais dans d’autres pays. En douce France, il n’y eut que des blessures graves (un membre sectionné par exemple), mais pas de victimes ; l’honneur est sauf. Le DRH lit une note qui décrit par le menu comment ces accidents sont survenus. J’étais encore très naïf à l’époque : je ne pensais pas qu’au XXIème siècle il y avait encore des personnes qui perdaient un bras, voire la vie en travaillant dans des fleurons industriels ; si bien que mon sang se glace. Je regarde autour de moi : je suis le seul à écouter. Les autres participants ont tous le nez sur leur ordinateur ou leur smartphone. Les morts et les blessés ? Tout le monde s’en fout. Je devine que la même scène doit se répéter chaque année : le DRH dit une fois par an que l’absentéisme est trop élevé et qu’il y a trop d’accidents de travail, les participants plongent le nez dans leur écran, puis le relèvent quand sera abordé un sujet plus intéressant à leurs yeux. Le sujet qui réveille la salle est un sujet RSE. L’entreprise doit-elle prendre en charge l’abonnement Vélib’ de ses salariés parisiens qui viennent de temps en temps travailler à vélo ? Puis les passions se déchaînent quand est abordée la prochaine campagne d’affichage en interne pour encourager le covoiturage. Face au choix cornélien entre l’affiche A et l’affiche B, toutes les têtes sont levées ; plus un seul smartphone n’est de sortie !
Cette réunion illustre comment les (grandes) entreprises adorent faire des choses au-delà de la loi au lieu de commencer par la respecter. Elles sont parfois plus motivées par la RSE que par le respect d’obligations telles que la préservation de la santé des salariés, oubliant au passage que la santé devrait être le socle de la RSE. Je ris sous cape quand une entreprise parle de RSE alors qu’elle a un taux d’absentéisme anormalement élevé. Il est tentant de mettre la charrue avant les bœufs ! C’est sûr qu’il est plus sexy et plus tendance de parler écologie et de jouer le rôle de chief happiness officer en organisant de temps en temps un apéro avec des pailles en carton plutôt que de mettre les mains dans le cambouis pour changer d’un iota l’ergonomie d’un poste de travail (sachant qu’un iota, sur le long terme, peut avoir des conséquences sur la santé loin d’être négligeables) ou de se battre pour que les salariés adoptent les postures qui réduiront leurs troubles musculosquelettiques (TMS), donc changeront totalement leur vie au travail, mais aussi leur vie tout court. D’ailleurs, est-ce la responsabilité sociale des entreprises de rendre leurs salariés heureux ? Qu’elles se contentent déjà de ne pas les rendre plus malheureux et mal en point que le jour de leur embauche : ce serait déjà bien !
D’aucuns diront que j’ai beaucoup travaillé sur l’absentéisme, si bien que je plaide pour ma paroisse. Mais je ris aussi sous cape quand une multinationale parle de RSE alors qu’elle ne paye pas (ou fort peu) d’impôts dans les pays où elle opère. J’attends encore que quelqu’un m’explique comment on peut oser prononcer le mot « responsabilité » quand on profite des infrastructures et de la main d’œuvre qualifiée d’un pays sans y contribuer !
La RSE ou l’art de faire du business autrement
La deuxième réunion marquante que je m’en vais vous conter portait quant à elle sur le mécénat d’entreprise. Je dois vous avouer que j’aurais du mal à être salarié d’une entreprise qui fait du mécénat. J’aurais du mal à entendre que mon employeur me demande de faire des économies et m’explique qu’il n’a pas les moyens d’améliorer mes conditions de travail, mais qu’il a en revanche les moyens de donner de l’argent à l’opéra pour que les amateurs de cet art (dont je fais partie) payent moins cher leur place ou bien d’aider le Louvre à rénover un tableau alors que c’est plutôt le rôle du ministère de la culture ou de mécènes privés de financer cela.
Mais bon, j’essaye de « challenger » de temps en temps mes convictions, donc j’étais prêt à changer d’avis. Mais ce ne fut pas le cas, bien au contraire ! Un des orateurs (qui travaillait pour un groupe de grande distribution) expliqua que le mécénat ouvrait des portes à moyen terme. Son groupe avait ainsi pu obtenir des avantages ou des concessions dans telle ou telle région grâce aux liens noués via le mécénat. Je suis à deux doigts de tomber de ma chaise. En gros, le mécénat est utilisé ici comme une forme de corruption. Mais une corruption douce, noble, pas un vulgaire dessous de table. On est entre gens bien élevés. On fait du soft power, de la responsabilité sociale. Ah bon !
Si la corruption me dérange, faire du business pas du tout. C’est précisément la raison d’être des entreprises ! Il serait donc mal venu de le leur reprocher ! Mais il est risible d’habiller de nouvelles idées de développement économique avec les habits neufs de la RSE. Au début des années 2000, la mode était au social business et à « la base de la pyramide ». Il s’agissait de développer des produits et services à destination des pauvres, mais pas de manière philanthropique : il fallait leur vendre des choses peu chères, donc à grande échelle et de faible qualité, afin de réaliser tout de même une marge. Très bien ! Pourquoi pas ? Il s’agissait tout simplement d’une adaptation du fordisme puisque Henry Ford souhaitait que ses ouvriers puissent acheter les voitures bas de gamme qu’ils contribuaient à produire. Mais il ne serait jamais venu à l’idée de Ford de se vanter de faire de la RSE ! Ou alors, si tout est RSE, en sus de la prose, Monsieur Jourdain faisait aussi de la RSE sans le savoir ! Dans la même veine, Ryanair et Free sont alors des modèles de RSE puisqu’ils ont participé à casser les prix dans l’aérien et la téléphonie, en se souciant moins des conditions de travail de leurs salariés que de leurs parts de marché, certes, mais c’est un détail.
La RSE ou l’envie d’être aimé
La troisième réunion indélébile dans ma mémoire était une sorte de master class donnée par un PDG. Une partie de son propos portait sur la RSE qu’il avait mis un point d’honneur à développer. Après toute une série d’arguments rationnels et sérieux pour justifier son intérêt pour ce sujet, il avait lâché une petite phrase du style « Et puis, je suis content de pouvoir raconter ce que nous mettons en place à ma femme et mes enfants » qui sonnait comme un moment de vérité. Comme si, après les paroles attendues, il dévoilait enfin à demi-mots ses motivations inavouées : se faire bien voir, se faire aimer des siens. La RSE était en quelque sorte le ciment de son couple, le pansement qui compensait sa faible présence auprès de sa famille ; il était peu présent, mais c’était pour la bonne cause : il faisait des choses bien. C’est plus mignon que de parler de RSE comme de la danseuse du président. C’est un constat, pas une critique. On a tous (moi le premier) envie d’être aimé. Et si ce PDG pousse son groupe à faire de la (vraie) RSE afin de gagner l’admiration de sa femme tel un chevalier courtois du Moyen-Age, tant mieux ! Surtout si elle lui demande quel est le niveau d’absentéisme et d’imposition de son entreprise.
Ce que je trouve plus gênant, c’est la communication exagérée qui va avec. Cette communication en dit beaucoup en creux. Un peu comme quand ton père qui ne s’abaisse jamais à débarrasser la table le fait une fois par an et éprouve alors le besoin de le clamer à la terre entière. Je ressens souvent cette impression à la lecture de rapports RSE qui s’apparentent à une liste à la Prévert, une liste interminable à en devenir ridicule. Tout est bon à prendre. On a un restaurant d’entreprise ? On va le mettre dans rapport RSE ! On ne torture pas nos salariés ? On va le mettre dans rapport RSE ! Etc. Ce besoin maladif d’être aimé me met aussi mal à l’aise que devant l’amoureux éconduit qui supplie sa dulcinée de l’aimer encore en lui dressant sous son balcon une longue liste de vaines promesses.Il faut d’ailleurs se méfier de ces listes de pratiques de RSE comme de la peste. Elles adoptent généralement la technique du clair-obscur2 qui consiste à mettre en lumière certains éléments pour la mieux en cacher d’autres. Par suite, ce qui compte n’est pas ce qui figure dans un rapport RSE mais ce qui n’y figure pas ; la poussière cachée sous le tapis.
La RSE ou l’envie de mettre un peu de piment dans sa vie à petit prix
La quatrième réunion qui m’a marqué est une réunion interne d’une entreprise en vue de faire le bilan de son action en matière de congés solidaires. Etaient alors invités le DG, le DRH, quelques autres personnes qui comptent et puis une partie des salariés qui ont donné de leur personne, en l’occurrence qui sont partis faire une mission humanitaire en Afrique pendant leurs vacances aux frais de leur employeur. Un cadre dirigeant se frotte les mains : avec la déduction fiscale à la clé, cela coûte peanuts pour un effet garanti : les salariés sont ravis, c’est une expérience inoubliable, ils ont l’impression qu’ils ont plus appris que donné, ils en tirent un fort sentiment de gratitude envers leur employeur, cela fait de belles histoires à raconter et une bonne image pour l’entreprise, notamment en interne. Quelques salariés sont un peu jaloux, mais la plupart trouve que leur employeur fait une bonne action.
Je relate cette réunion à des étudiants en école de commerce. Leur réaction, quasi unanime, est négative : Ah ces gens dans la crise de la quarantaine qui ont un boulot ennuyeux et une petite vie moribonde qui ont donc besoin de chercher du sens en allant se donner bonne conscience en allant aider pendant deux semaines les petits Africains qui meurent de faim !
Je comprends la réaction de mes étudiants. Mais qu’importe ? Les salariés volontaires, les Africains concernés, les dirigeants et la directeur RSE sont contents. Bref, tout le monde, il est content ! Tout le monde il est gagnant ! Sauf les étudiants ronchons qui y trouvent à redire, mais seront peut-être bien contents d’y participer dans 15 ans s’ils en ont l’occasion. J’invite mes étudiants à changer leurs représentations : avant de servir la société toute entière et de « sauver le monde », la RSE sert avant tout à faire plaisir aux membres du département RSE et à ceux qui participent à ses actions. Qui sommes-nous pour juger des gens qui mettent un peu de piment dans leur vie à petit prix ?
Etre un directeur RSE, tu sais, c’est pas si facile !
Du temps où j’étais naïf (oui, je l’ai beaucoup été, mais le suis de moins en moins !), je croyais que directeur RSE était le plus beau métier du monde. Je croyais qu’on y trouvait du sens et un sentiment de faire le bien à des conditions matérielles bien plus avantageuses que celles proposées pour un poste dans une petite association humanitaire par exemple. J’ai bien vite déchanté comme je le raconte dans mon prochain livre qui est un récit romancé (car anonymisé) de mon expérience au sein de la Direction du Développement Durable d’une grande entreprise française : le meilleur job du monde sur le papier peut devenir un cauchemar en réalité3.
Mais pour l’heure, je vais me contenter de relater une cinquième réunion marquante. Le directeur RSE d’un grand groupe pharmaceutique présente son métier dans un forum pour étudiants. Son PowerPoint met en avant les actions de son groupe dans ce domaine. Il pensait provoquer de l’admiration dans le public et donner envie à des étudiants de postuler à des stages au sein de sa direction. Mais tout ne se passa pas comme prévu. 90 % des questions étaient des critiques : « C’est tout ? », « Pourquoi vous ne faites pas ceci ? », « Vous devriez faire cela ! », etc. Le directeur RSE ressortit lessivé de cet échange, dépité, la mine aussi déconfite que Jacques Chirac en avril 2005 au sortir de son dialogue avec des jeunes sur le référendum sur la constitution européenne quand il avoua qu’il ne les comprenait pas.
Si je suis très critique envers la RSE, je le suis bien moins envers les directeurs (ou directrices bien entendu) RSE. Je ressens de l’affection, presque de la pitié pour eux parce qu’ils ne font pas un métier si facile. Ils prennent en effet beaucoup de coups en raison des attentes suscitées par leur titre. On demande bien moins souvent aux directeurs financiers ou marketing d’expliquer leur politique et de rendre des comptes !
Le problème, c’est que la RSE fait écho à la vertu. La politique RSE d’une entreprise est alors analysée sous l’angle moral et non pas uniquement sous l’angle productif ou financier. C’est la rançon à payer par ceux qui prétendent faire le bien. Agnès Jaoui le montre magnifiquement dans son film Place publique (2008) : elle joue le rôle d’une femme portée sur l’humanitaire alors que son mari (Jean-Pierre Bacri) est un homme égoïste et imbu de lui-même. Paradoxalement, leur fille est bien plus critique envers sa mère qu’avec son père parce qu’elle sait depuis le départ que son père est un « connard » : au moins, lui, il ne crée pas d’attentes, donc il ne déçoit pas !
Critiqué de toute part, le directeur RSE doit se défendre à grands coups de « C’est mieux que rien », « Faut voir le verre à moitié plein », « On est en progrès », etc. Il se prend en pleine tête toutes les contradictions de l’entreprise alors qu’il n’a point le pouvoir de les gérer, loin de là. Il récolte toutes les questions qui devraient plutôt être adressées au PDG en tant que décideur. Car les sujets sérieux sont précisément trop sérieux pour entrer dans le périmètre de la RSE. Quand on discute avec des directeurs RSE, leurs réponses sont bien souvent : « Je n’ai pas la main là-dessus ! », « Ah, non, ça c’est le rôle du DRH ! », etc. En outre, les directeurs RSE ne sont pas forcément à l’aise avec certaines pratiques de leur entreprise, mais doivent s’asseoir sur leurs états d’âmes. Par exemple, un directeur RSE que je connais estime lui aussi que le premier acte de RSE pour une entreprise est de payer des impôts, tandis que son entreprise a des pratiques plus que limites dans ce domaine. Son métier consiste à obtenir quelques succès, mais aussi à avaler beaucoup de couleuvres. Peut-être démissionnera-t-il un jour comme Nicolas Hulot en clamant « Je ne veux plus me mentir », « Je me suis surpris à des moments à abaisser mon seuil d’exigence ». Personnellement, si j’étais DRH, je m’assurerais que tous les membres du département RSE soient supervisés par un psy afin de m’assurer de la préservation de leur santé mentale.
La RSE comme mouche du coche ou business partner
Il est très facile de casser du sucre sur le dos des politiques RSE. Je voudrais donc me montrer également constructif en soulignant la posture intéressante que peuvent adopter des directions RSE en tant que poil à gratter ou empêcheur de tourner en rond. Il s’agit de jouer le rôle d’aiguillon en encourageant l’entreprise à faire du business autrement, en adoptant des pratiques plus vertueuses tout en gardant l’objectif de fabriquer du profit. Pour cela, la direction RSE ne peut bien entendu pas agir seule, à l’instar des directions de l’innovation qui n’ont pas le monopole de l’innovation, mais la vocation de développer partout une culture de l’innovation. Il y a toutefois deux façons de jouer ce rôle d’aiguillon : une positive, l’autre négative. Commençons par la négative que j’appellerais la technique de la mouche du coche en référence à la fable éponyme de La Fontaine. Un coche montre péniblement une côte quand :
« Une Mouche survient, et des Chevaux s’approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l’un, pique l’autre, et pense à tout moment
Qu’elle fait aller la machine,
S’assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;
Aussitôt que le char chemine,
Et qu’elle voit les gens marcher,
Elle s’en attribue uniquement la gloire ;
(…) Ainsi certaines gens, faisant les empressés, S’introduisent dans les affaires : Ils font partout les nécessaires,
Et, partout importuns, devraient être chassés. »
Le risque pour les départements RSE est ainsi de se placer au-dessus du lot et de se contenter de donner des ordres sans contribuer d’une once à leur mise en œuvre.
Une posture plus humble et plus intéressante consiste à se positionner moins en ministère de la parole qu’en ministère du soutien, c’est-à-dire d’assumer d’être une fonction support, au sens premier du terme, tout en se montrant opérationnel. Cela passe par une posture de servant leadership ou de business partner en direction des autres départements de l’entreprise, sur le mode : mettons ensemble les mains dans le cambouis pour trouver des solutions, par exemple en faisant de la recherche-action ou en adaptant de bonnes pratiques repérées ailleurs. Loin du donneur de leçon, le département RSE est chercheur de solutions. Il ne s’agit pas de s’exclamer « Il faudrait faire cela ! », mais « Voyons ensemble comment être intelligents et créatifs pour lier autant que possible pratiques vertueuses et profits ! »
Ce rôle d’aiguillon peut s’accompagner au besoin d’un peu de manipulation au sens de faire faire des choses à une autre direction qu’elle n’avait pas prévue de faire. Je vous donne un exemple. Un directeur RSE nota que son entreprise ne faisait pas grand-chose pour réduire le plafond de verre ; il y avait des pratiques de discrimination envers les femmes en interne sans que personne ne s’en émeuve. Puisque le DRH ne s’emparait pas du sujet, il alla voir le PDG et le convainquit qu’une politique d’égalité professionnelle ambitieuse serait un moyen de transformer la culture d’entreprise et de renouveler une partie des équipes dirigeantes. Le DRH, désireux de se faire bien voir et de ne pas se faire voler par son collègue de la RSE un sujet porteur, leva la main en Comex pour être le porteur de cette politique et la mena à bien car il se savait sous l’œil de ses pairs. Par ce coup de billard à deux bandes, le directeur RSE joua donc un grand rôle dans la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans son entreprise.
Commentaires, critiques et questions sont les bienvenues à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Je considère la RSE comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir « davantage » dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes ». Il s’agit de la définition proposée par l’Union Européenne dans son livret vert de 2001. Cf. https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=CELEX :52001DC0366 Mais mon propos serait le même à partir des autres définitions classiquement utilisées.