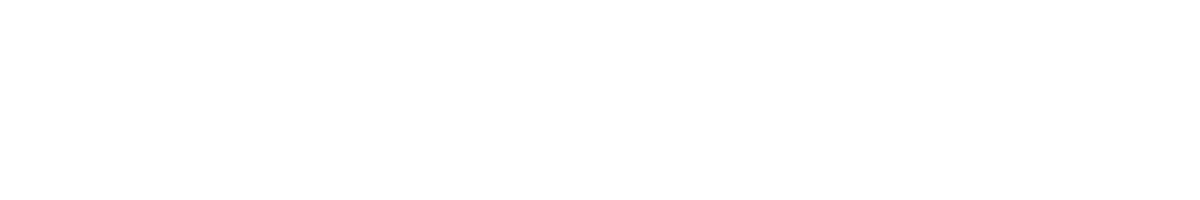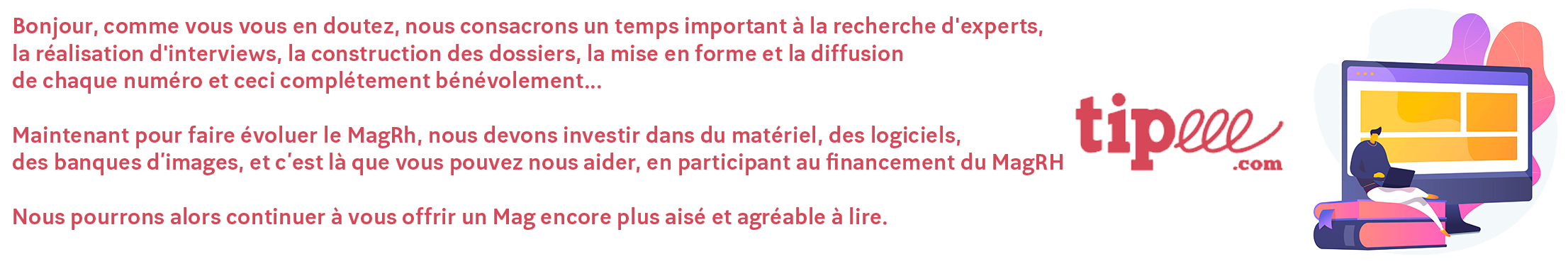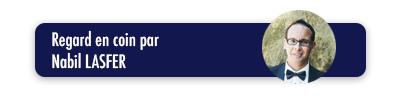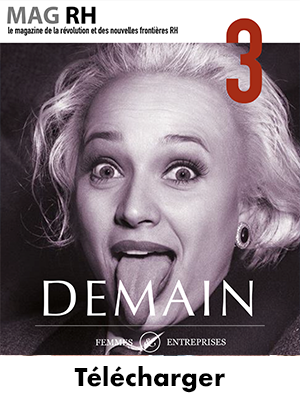Chantal HEMARD & Gérard REYRE
L’autoévaluation se présente sous de multiples facettes dont, en particulier, les sciences de l’éducation se font l’écho depuis de très nombreuses décennies pour dénouer et éclairer la complexité de l’individuation et son rapport à l’apprentissage. Par contre, il faut attendre une période plus récente pour que la poussée de l’individualisation et particulièrement son entrisme dans l’entreprise mette en exergue qu’en toute simplicité, le destin d’un individu lui appartient quoiqu’il lui arrive.
Lui donner la parole ne procède pas d’un seul point de méthode qui consisterait à ce que l’on attend par exemple d’un apprenant : « accepter de voir en arrière pour porter un œil critique sur soi, appuyé sur des critères (…), conduisant à une prise de décision pertinente et efficiente sur la base d’un référentiel intériorisé. Cette aptitude réflexive permet une prise de conscience de son action ; lucidité indispensable à tout apprentissage signifiant que seul l’élève, en tant que sujet, peut réaliser. ». L’enjeu est tout autre en entreprise, même si, dans l’absolu, cette dimension d’apprentissage est centrale pour le développement d’une personne. Nous ferons l’hypothèse que l’autoévaluation dans sa version entrepreneuriale est frappée d’une ambiguïté majeure qui fait tanguer le dispositif d’évaluation et sa récente promotion de l’autoévaluation vers l’auto-admonestation du contrôle par l’intériorisation de la mesure prescrite et sa dérive vers la sanction.
Le cas d’une entreprise
En chapeau de cet article, nous présentons le cas d’une entreprise ayant instauré une autoévaluation lors de la mise en place d’un outil informatique d’évaluation individuelle des salariés. Ce fut l’un des principaux motifs d’une demande d’expertise de la part des CHSCT de l’ensemble des établissements de l’entreprise.
L’inscription de l’autoévaluation dans un système informatique vient en quelque sorte révéler de manière saillante les effets ambigus de l’autoévaluation que nous décrirons plus loin.
Le terme d’autoévaluation était déjà présent dans les documents préparatoires à l’entretien avant l’introduction de l’outil Il y était précisé que l’entretien d’évaluation étant « une responsabilité partagée », sa qualité reposait sur la richesse de la préparation lors de laquelle le salarié était censé s’auto-apprécier à l’aide du support d’entretien vierge. L’autoévaluation ou auto-appréciation était donc un terme déjà présent dans l’ancien système mais dans la perspective de se préparer à participer à l’entretien.
Cette séquence était effectivement une habitude bien instaurée au sein de l’établissement enquêté. Dans l’ancien système (datant des années 90), il était admis que salarié et responsable hiérarchique devaient préparer chacun de leur côté l’entretien dans la visée de partager leur évaluation de l’année.
Ainsi, ce que proposait l’outil informatique renforçait en quelque sorte cette pratique en apportant une fonctionnalité supplémentaire qui était celle de formaliser l’autoévaluation et de l’adresser avant l’entretien au responsable hiérarchique. C’était cette fonctionnalité qui était mise en question par les salariés. Pourquoi ?
Tout d’abord, du fait de l’impossibilité d’effacer l’autoévaluation à l’issue de l’entretien. Car, tant les évalués que les évaluateurs considéraient que l’entretien apportait de nouveaux paramètres venant changer la perception et donc l’évaluation de l’un et l’autre.
Ainsi, par exemple, dans le cas où le salarié avait sous-estimé sa performance, ce qui a été observé à plusieurs reprises par les managers, cette autoévaluation restait malgré tout tracée dans l’outil. Cette situation pouvait, alors, induire une présomption d’indulgence excessive ou de « manque de courage » de la part du responsable, avec la nécessité pour lui d’avoir à se justifier auprès de ses propres responsables ou de la DRH.
À l’inverse, dans le cas où le salarié avait surestimé sa performance, il pouvait y avoir soit le soupçon d’une sévérité excessive de la part de son responsable à son encontre soit le soupçon d’un manque de réalisme de sa part sur le niveau de sa contribution.
Des échanges entre managers lors d’un entretien de groupe ont montré l’avantage donné au manager par la communication de l’autoévaluation avant l’entretien. En effet, cette dernière pouvait accentuer l’asymétrie entre un salarié et son supérieur hiérarchique. Certains managers étaient mal à l’aise, d’autres pouvaient en tirer parti.
Il y avait donc une simplification apportée aux managers dans le sens où ils connaissaient, avant l’entretien, le point de vue du salarié. Cet avantage déclenchait chez ce dernier des hésitations sur le meilleur positionnement à effectuer selon le « caractère » de son responsable.
Les témoignages entendus au cours de l’enquête nous ont permis d’imaginer un dialogue intérieur des salariés : « Face à X, il est préférable que je me sous-évalue pour lui offrir la possibilité de me valoriser. Oui, mais jusqu’où va-t-il le faire ? Ne va-t-il pas profiter de ma sous-estimation pour évaluer en deçà de ce qu’il aurait fait sans mon autoévaluation ? Face à Y, a priori peu reconnaissant, il sera préférable de me surestimer pour tenter de le tirer vers une évaluation plus favorable que celle qu’il aurait naturellement faite. Oui, mais comment va-t-il le prendre, cela peut l’agacer ? ». Nous avons rencontré beaucoup de salariés préoccupés par ce dilemme. Certains, même, nous ont paru de fins stratèges.
« Il y a eu des écarts plutôt en ma faveur entre les deux évaluations : je me suis sous-évalué, sur certains postes. Pour d’autres postes, je me suis forcé à m’évaluer plus positivement, je me suis dit « je suis à la limite » et je me suis mis au-dessus »
« Si l’autoévaluation est saisie dans l’outil, je ne l’aurais pas fait de la même manière. J’aurais mis des valeurs claires et précises, par exemple ici, j’ai mis 100%+, j’ai mis atteint (dépassé), je n’aurais pas mis de parenthèses, j’aurais écrit ce qui est avantageux pour moi, j’aurais mis le plus favorable pour moi parce que c’est inscrit, aussi je me suis rendu compte que quand on met noir sur blanc un niveau cela tire l’interlocuteur vers ce niveau, on bataille pour arriver au niveau où on veut être. ». Pourtant, il semble que la plupart des salariés aient choisi de se sous-évaluer. Les managers rencontrés ont constaté que c’était, effectivement, plus facile pour eux. Lorsque nous leur avons demandé si c’était une stratégie de la part du salarié ou une tendance à mal estimer leur performance, ils ont opté pour la seconde proposition. Ce fut confirmé par des salariés :
« L’autoévaluation c’est dangereux parce qu’il y a des gens qui ont tendance à se sous- évaluer, c’est piégeant. Ils se sous-évaluent par manque de confiance en eux. »
Ainsi, le risque de l’autoévaluation pour les salariés était réel. De surcroît, ce jeu de « plus » ou de « moins » incitait la prudente notation moyenne conditionnant par ailleurs la non augmentation salariale.
Par ailleurs, certains responsables des Ressources Humaines eux-mêmes reconnaissaient les ambiguïtés de l’autoévaluation: « S’il n’y a pas d’autoévaluation, il peut y avoir négociation. Avec l’autoévaluation, cela va être beaucoup plus dur. L’objectif c’est quand même de remotiver les personnes. »
Quant aux managers, ils ont soulevé les risques de dégradation de la qualité de l’entretien annuel:
- « L’an dernier, ils l’avaient préparé. Mais cela n’a pas de sens de demander aux personnes de s’auto noter. Il y a quand même des risques. »
- « C’est assez déstabilisant, j’ai le cas d’une personne qui s’est auto évaluée à 150 % partout. J’en ai été agacée, car pour moi, c’était uniquement normal. Je me suis armée au début de l’entretien, cela s’est calmé tout de suite car le salarié avait joué ».
- « C’est dommage de ne pas attendre l’entretien pour discuter. Cela crée des phénomènes de pré-entretien qui peuvent tuer l’échange ».
- Les salariés, de leur côté, ont largement exprimé leur malaise face à l’autoévaluation. D’abord un sentiment d’injustice :
- « Ce n’est pas juste l’autoévaluation, l’employeur n’a rien à perdre, on n’est pas en position gagnante pour nous, ce n’est pas dans les deux sens. »
- « On remplit l’autoévaluation et on l’envoie au manager, aussi honnête soit-il, c’est injuste parce que le manager prépare ses arguments et après on arrive la fleur au fusil »
Puis, son effet réducteur avec l’instauration d’un manque de confiance avant l’entretien :
- « La seule chose que le manager va voir avant l’entretien, c’est le % d’atteinte des objectifs, ce n’est pas représentatif. Même si je m’évalue avant, on évaluera à deux après, le manager risque d’être influencé ….ce sera faussé. »
- « Ce qui est pernicieux, c’est l’autoévaluation, de l’envoyer en avance au manager, elle est stressante, je l’ai pris au début comme un jeu mais j’ai stressé pour le remplir de façon juste. »
Ensuite le dilemme que nous avons déjà évoqué :
- « J’ai mis beaucoup de temps à le faire parce que c’est difficile, on hésite entre se sous évaluer ou se sur évaluer, cela m’a beaucoup stressé. »
- « Cela m’a mis à mal à l’aise : soit on veut être honnête et on se tire une balle dans le pied, soit on est 100 % partout et cela ne sert plus à rien. Je ne suis pas sûr de voir la valeur ajoutée. Cela m’a évoqué les sessions d’autocritique en Chine populaire. »
- « Je peux comprendre que l’autoévaluation ne soit pas facile pour tout le monde. Certaines personnes doivent se demander si elles mettent « maîtrise » et que si leur chef met « pratique », cela va les desservir. »
De cette enquête et de nos expériences partagées que peut-on tirer comme remarques et réflexions ? Encore faut-il d’abord s’interroger sur la nécessité devenue si vitale de donner la parole au salarié dans le dispositif d’évaluation.
Pourquoi faudrait-il donner la parole à l’évalué ?
Cette question légèrement provocante oblige à rappeler que la participation de l’évalué à « son » évaluation n’a pas été uniforme au fil du temps et que sa parole n’a pas toujours été convoquée utilement pour satisfaire au dispositif. Jusqu’à l’orée des années 80, les grilles utilisées pour l’évaluation du personnel n’impliquaient nullement que l’évalué puisse prendre la parole pour évoquer l’année écoulée. Il s’agissait, pour chacun, d’aller chercher la note ou l’appréciation qui déterminerait, au regard de critères non contestables, sa rémunération pour l’année à venir. Seuls les managers et les cadres les plus éclairés devinaient que l’issue de l’entretien serait plus favorable si l’évalué avait pu dire quelques mots sur ce qui le concernait au premier chef, son travail. La décennie 80/90 a vu l’effervescence évaluative s’emparer des univers privés puis publics de production. Là, la consigne devient plus sophistiquée. Il convient de chercher un accord entre les deux acteurs en présence pour finaliser la chose et, surtout, qu’elle n’embolise pas la relation manager-managé pour l’année à venir. Pour ce faire, peu à peu, apparaissent des consignes qui visent à assurer la meilleure préparation possible aux deux personnes. Chacune, de son côté est censée se préparer au regard des règles et procédures prévues par le système d’évaluation choisi par l’entreprise. Chemin faisant, les référentiels et les critères de jugement ont, eux aussi, évolués tout en conservant la même idéologie managériale basée sur l’inébranlable culture du résultat et son faisceau de critères prétendument objectifs, rationnels et finalement normatifs étalonnés sur plusieurs niveaux.
Aujourd’hui, et après une littérature critique plus qu’abondante sur le sujet, certaines entreprises estiment qu’elles ont suffisamment dépensé, en temps et en argent, pour arriver à un système toujours insatisfaisant. Elles ont donc décidé de supprimer la procédure et de la remplacer par deux-trois clics sur une application qui statue de la conformité d’un individu à rester dans l’entreprise après sa contribution à un projet.
Pour les autres, moins radicales sans doute, vaguement influencées par les avancées de la sociologie et de la psychologie du travail, elles espèrent avoir trouvé dans l’autoévaluation la solution aux impasses maintes fois identifiées de l’évaluation. Procéder à son autoévaluation n’est-ce pas l’aboutissement de la quête de cette affaire, dire le « vrai » sur son travail et en assumer les conséquences ? Il faut que chacun puisse, en responsabilité, faire son bilan et tirer tous les enseignements utiles pour sa progression dans l’entreprise. N’est-ce pas reconnaître l’autonomie des individus que de leur donner la parole et qu’ils fassent ce travail, complexe, délicat, mais tellement attendu par le management ? On notera que cette focalisation sur la parole de l’individu éloigne du regard les critères et les « notes » auxquels ils sont pourtant toujours soumis, mais il ne s’agit pas au final de sortir des canons du modèle. Etre conforme tout en se différenciant, voilà la pseudo-marge de liberté concédée sur le territoire de l’individualisation.
Le paradoxe (la manipulation ?) se dévoile plus complètement s’il en était nécessaire lorsque l’on rapproche les deux exigences. Comment se situer dans un univers normatif bardé de chiffres et de repères temporels alors que l’action de chacun s’élabore au jour le jour dans la confrontation aux contraintes du travail et ce qu’elles supposent d’intelligence dédiée à leur dépassement ?
Evaluer, donner de la valeur à ce qui existe ou à ce qui a existé, pour un individu, c’est être préoccupé par la vérité de l’entendement par rapport à la vérité de l’existant, comme disait Ardoino Dans l’échange entre l’évalué et l’évaluateur, il ne peut y avoir que maldonne lorsque l’un cherche la « preuve » sous prétexte d’objectivité et de contrôle alors que l’autre exprime sa vérité, celle qui cherche à exprimer la réalisation plutôt que le résultat, la vérité éprouvée, ressentie dans l’épreuve, à travers les événements et les situations de la vie quotidienne au travail. En cela, le témoignage n’est pas autre chose que subjectif. Il se déplace sur la crête des choses vécues, il ne fournit aucune preuve et il peut être confronté à d’autres points de vue. En cela, il est relatif et se déplace dans un univers perclus d’incertitude mais de familiarité avec les choses ou les services produits.
C’est ce que d’ailleurs nous ont confirmé les salariés et leurs managers dans le cas présenté ci-dessus.
De l’autocontrôle comme avant-goût à l’autoévaluation
Dans les sociétés industrielles des années 30, l’autocontrôle est d’abord l’aboutissement d’une préoccupation majeure : faire face à la crise de 29 qui provoqua une chute de la production et donc du chiffre d’affaire.
Dans un premier temps, et dans la suite logique de l’implantation de l’Organisation Scientifique du Travail, les efforts sont orientés vers une double finalité : abaisser les coûts et trouver de nouveaux débouchés. Ces efforts se traduisent par une volonté de contrôle, d’abord budgétaire, dont la visée est de fixer les économies réalisables, puis, par extension, de réduire les dépenses prévues. Le regard se porte alors naturellement sur le gaspillage que les industriels (en particulier ceux de la mécanique et de l’automobile) souhaitent combattre sous deux formes : la réduction des frais de fabrication et l’amélioration de la qualité des produits. Dans un premier temps c’est sur les cadres que portent les recommandations de lutte contre le gaspillage. Louis Renault, très en pointe sur la question, enjoint ses cadres à contraindre les ouvriers aux principes d’économie. Pour appuyer leur action sont créés ici et là des « services des économies » capables d’effectuer toutes les mesures augmentant la rentabilité des dépenses.
Côté gaspillage, on renforce la prescription. Chacun est censé ne faire que ce qui lui est strictement demandé à partir d’un cahier de fabrication, l’agent de maîtrise ayant pour tâche de superviser un vérificateur et de contrôler à travers lui la conformité de la production avec celle qui est exigée. L’objectif est de rendre responsables tous les exécutants de la qualité de cette production alors même qu’on élève les rendements pour abaisser les prix de revient. Ce choix confronte inévitablement quantité et qualité, les contremaîtres étant payés au rendement… Chez Renault ce système n’est pas maintenu pour des motifs d’économie. C’est à ce moment-là que dans les ateliers de mécanique, les contrôleurs sont remplacés, autant que possible, par des équipements permettant aux ouvriers de vérifier eux-mêmes la qualité de leur travail. Ce sont les tous premiers signes d’un autocontrôle de son travail par le travailleur bien qu’à l’époque les préoccupations majeures ne soient pas centrées sur le travail des ouvriers soumis au chronométrage et au rendement mais sur la conception des véhicules, la préparation de l’outillage, la simplification des pièces et la rationalisation des gammes, etc.
Vient ensuite un bref passage par un système de suggestions de type boîte à idées très diversement appliqué et non rentable qui sera rejeté par les chefs d’entreprise peu enclins à faire confiance à la méthode.
Il faut attendre l’immédiat après-guerre pour trouver, au travers des activités Kaizen chez Toyota, une gestion directe du personnel organisée autour du système de suggestions et des cercles de qualité. Il s’agit, dans les deux cas, d’inciter les agents de fabrication à l’amélioration de leur lieu de travail et de la qualité des produits.
Au plan individuel, rappelons brièvement en quoi consiste l’autocontrôle tel qu’il est imaginé dans les années cinquante.
L’autocontrôle est un instrument de mise en autonomie et de responsabilisation des opérateurs destiné à résoudre au plus tôt, c’est-à-dire dans le flux, des problèmes de non-qualité et à traiter de façon durable les défauts récurrents grâce à une analyse qu’autorise un dispositif de traçabilité. A travers l’autocontrôle, c’est tout un système de contrôle qualité, longtemps conçu comme un tri en bout de chaîne qui se trouve profondément remodelé pour conduire l’entreprise sur le chemin du zéro défaut. On devine l’idéal sous-jacent, celui d’un accord parfait entre les intérêts de l’ouvrier et ceux de l’entreprise. Ce sera l’axe pédagogique majeur du management « officiel » pour les cinquante ans qui suivront : convaincre de cette confluence d’intérêts tous les salariés et en particulier les moins bien payés.
Pour autant, en pratique, vont se jouer d’autres figures bien mises en évidence par les nombreux travaux de sociologie du travail pendant la même période et qui vont s’échouer sur cette nouvelle attraction qu’est l’autoévaluation.
En effet, que se joue-t-il en arrière-plan de l’autocontrôle ? D’abord, fondamentalement, un appel à la responsabilité qui vise deux aspects du sujet, celui du salarié en prise dans son rapport au contrat (y compris moral) avec l’entreprise et celui du professionnel confronté au défaut, au gaspillage, qu’il ne peut pas ne pas dénoncer au nom de l’honneur de son métier. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’engagement professionnel est directement sollicité au plan de la méthode puisqu’on ouvre la possibilité d’une prise d’initiative qui émane de la responsabilité individuelle. On sait les préventions paradoxales et/ou ambigües d’un management qui appelle en général l’initiative pour, assez rapidement, en encadrer les effets. Il y a donc risque pour l’opérateur à s’engager dans l’autocontrôle si le droit à l’erreur n’est pas ouvertement et complètement autorisé. Il suffit classiquement pour s’en assurer d’identifier le nombre de strates qui définissent, encadrent et formalisent les modes opératoires. Lorsque les managers n’ont aucune prise sur la traçabilité des contrôles, les opérateurs ont quelque excuse à prendre des précautions pour s’exprimer sur les problèmes qu’ils rencontrent dans la production car l’effet le plus délétère de la responsabilité est d’en faire une affaire strictement personnelle alors que les processus, les dispositifs et le plus souvent d’autres acteurs sont inclus dans la situation qui supporte le problème.
Une tentative disciplinaire de compenser l’écart entre travail prescrit et travail réel ?
Le temps n’est plus où l’on pouvait systématiquement projeter sur les activités de travail la figure classique de l’artisan pour en souligner la nécessaire totalité, le métier complet et ses composantes : l’engagement du corps et l’intelligence de l’auteur. Avoir une représentation de l’ensemble du processus de fabrication, en connaître les finalités et les usages n’est plus l’apanage que des artistes et de rares artisans. L’activité se présente aujourd’hui, dans la plupart des entreprises, de façon découpée, fractionnée, connectée à de multiples applications informatiques soumises à leur propre rendement et peu sujettes à contestation. Se redécouvre à bas bruit un pan de l’histoire de la sociologie du travail : la dissociation du travail et du travailleur.
Derrière ses fonctions de captation et d’enrôlement généralisées, la digitalisation produit un déplacement de la notion d’autonomie. L’autonomie des individus est prescrite mais contrôlée. Par contre, celle des outils informatiques est libérée par la fameuse « disruption » (des produits, des systèmes, etc.) et le plus souvent inaccessible à l’intervention du salarié lambda. Comme l’indiquait Naville dès 1963 « le fonctionnement autonome des outillages est tel que l’individu ne sait pas comment il intervient en tant que tel ».
Tout le monde sait aujourd’hui qu’agir ne se limite pas à appliquer automatiquement un programme ou des objectifs préétablis (la prescription), ce qui dispenserait de tout échange, de toute communication, mais exige d’interpréter la situation et de faire face aux circonstances. Paradoxalement, chacun en a fait l’expérience, c’est lorsque la règle, la prescription, contraignent l’action que c’est là que la marge de manœuvre et la part d’interprétation se révèlent les plus indispensables (cf. travail réel). On comprend immédiatement qu’il faut pouvoir disposer d’un espace où cette dialectique de l’action doit pouvoir être abordée car il faut instamment que cette contextualisation, l’accès au réel, soit traitée pour avoir accès, non seulement au sens mais aussi à la viabilité du travail.
Depuis quelques décennies, les rôles et les fonctions se sont ouverts et ne prescrivent plus le détail des conduites (non par philanthropie mais du fait de la complexité des choses, des objets et de la technique). Il revient à chacun de compléter, de nuancer, de confronter sa vision à celle des autres. Il faut désormais souvent agir dans l’incertain et l’approximatif, en tentant, chemin faisant, de donner un sens à ce qui se passe, de l’inférer à partir de son expérience et des sentiments qu’il suscite (le vécu), d’où l’importance accordée à la discussion pour évaluer, dans notre cas introductif.
Le travail est donc structurellement situé, construit (ou déconstruit) sur le moment, et pas à pas, selon des interprétations du contexte, par les acteurs en présence et selon leurs intentions. C’est ce qui fonde sa nature coopérative. Le travail n’est donc jamais simplement exécuté mais, à la mesure de la situation, réinventé (c’est d’ailleurs pourquoi on pourrait plus précisément parler de « savoir s’y prendre » plutôt que de « savoir-faire »).
En conséquence on pourrait s’attendre à un accroissement généralisé des débats et des postures critiques vis-à-vis de ce que le travail fait à l’homme et inversement. Or, c’est le contraire qui se passe. Plus les outils digitaux se multiplient et moins il y a d’échanges entre les personnes. La croyance contemporaine est que, face à son ordinateur et aux montagnes d’informations dont il dispose désormais, chacun peut faire les bons choix, s’orienter avec conscience et intelligence, faire ses propres bilans et tresser les fils de ses prochaines aventures. Et s’il n’y arrive pas du premier coup, d’autres « applis » suivront, plus pointues, plus appropriées. Telle est la promesse diffuse qui condamne l’individu à atteindre inéluctablement son niveau d’incompétence dans la course poursuite qui s’est engagée entre l’homme et la machine. Naville, encore lui, voyait déjà le risque de voir s’élargir le fossé entre une « élite instruite » seule capable de maîtriser les ensembles automatisés et des équipes reléguées à un travail de surveillance parcellaire.
Il serait techniquement possible désormais de procéder à l’évaluation de son travail, de faire le bilan de sa contribution dans des projets, d’identifier ses compétences grâce aux référentiels fournis, de se projeter potentiellement sur d’autres postes, de livrer ses espoirs de promotion, de solliciter des formations, bref de devenir son propre manager et son DRH personnel !
La dernière agilité du moment consiste donc à ce que chacun se pose les « bonnes » questions et trouve lui-même ses propres réponses. La représentation sous-jacente est celle d’un salarié en devenir d’autoentrepreneur, à la fois au plan économique et à celui de l’évaluation de ses actes. C’est ce qu’on appelle avec emphase « prendre ses responsabilités » !
Or « prendre ses responsabilités » dans un collectif tel que l’entreprise présente de multiples risques que tout salarié est amené à mesurer avant d’agir. Nous l’avons bien vu dans notre cas. Les salariés sont incités à prendre la responsabilité de leur évaluation. Ils sont d’accord pour préparer un échange avec leur évaluateur, sans doute en s’auto-évaluant mais à condition de disposer d’ajustements possibles pour parer à tous les risques que représentent « l’aveu » dans un univers où la préservation de sa place est un enjeu permanent.
Malgré cela, les DRHc onsidèrent que l’autoévaluation est finalement la solution pour faire face aux impossibilités de l’évaluation : contraindre le salarié à avouer pour mieux l’évaluer.
Gouverner les hommes par leur propre vérité
Nous avons traité ailleurs de la question de l’aveu et de sa pénitence dans l’histoire du christianisme et son rebond dans celle de l’entreprise, via, en particulier, l’entretien d’évaluation annuelle. Nous y revenons ici succinctement pour en pointer l’actualité vis-à-vis de l’autoévaluation. L’aveu est une façon d’être lié à une obligation de vérité. Il faut, pour avouer, reconnaître l’action commise, mais, plus encore, signifier que l’on connaît nous-mêmes notre vérité, la raconter et accepter de la reconnaître comme véridique. Il s’agit bien de dire la vérité de ce que nous sommes, de nous dévoiler et ce, face à un dépositaire, confesseur ou confident, médecin ou… manager (comme si ce dernier était un acteur neutre, or nous avons vu dans le cas introductif la complexité de ses enjeux et donc sa position forcément ambigüe pour évaluer un salarié dans un système à visée gestionnaire).
Chez les moines l’aveu est une technique de travail de soi sur soi avec une visée d’élévation spirituelle. L’individu témoigne en définitive contre lui-même puisqu’il existe un lien entre « les obligations de vérité qui concernent la foi et celles qui touchent à l’individu. Ce lien permet une purification de l’âme, impossible sans la connaissance de soi ». Le pêcheur sollicite la pénitence. C’est toujours lui qui doit expliquer ses fautes et justifier des raisons qui le poussent à désirer le statut de pénitent. Il va voir son supérieur et le prie de lui imposer son statut de pénitent. L’aveu du pénitent est à la fois le signe d’une autopunition et l’exercice d’une révélation de soi. On ne peut distinguer, dit Foucault, « les actes par lesquels le pénitent se punit de ceux par lesquels il se révèle ». Il lui faut afficher sa souffrance, manifester sa honte, donner à voir l’humilité et exhiber la modestie ; tels sont les traits majeurs de la punition. Le plus important finalement n’est pas de révéler la vérité du péché, mais de montrer la véritable nature du pécheur. Ce travail de pénitence qui consiste à reconnaître les obligations morales imposant à l’individu sa conduite est un mode d’assujettissement sophistiqué sous-tendant un principe de gouvernement qui ne l’est pas moins.
Avouer procède d’un travail très particulier, un examen de soi.
L’herméneutique de soi chrétienne se fonde sur l’idée qu’il y a en nous quelque chose de caché, et que nous vivons toujours dans l’illusion de nous-mêmes, une illusion qui masque le secret.
Cette pratique de soi passe non pas par la subjectivation du vrai, mais par la véridiction de soi, par l’objectivation de soi dans un discours de vérité qui a la forme de l’aveu, et qui a pour but la production de l’obéissance. Si ce moment engage jusqu’à notre mode d’être de sujet moderne, c’est qu’il s’agit du moment à partir duquel la pratique qui consiste à dire vrai sur soi, la verbalisation herméneutique de soi devient l’une des formes fondamentales de notre obéissance.
Mais comment faire pour discriminer le bon grain de l’ivraie, les bonnes des mauvaises pensées ? Le seul moyen est de se confier à son directeur, son maître et de verbaliser toutes nos pensées ainsi que nos penchants, nos intentions les plus intimes.
La confession devient alors la technique qui permet à chacun d’opérer cette discrimination à l’oreille du maître même si celui-ci ne dit rien. Le fait de dire opère déjà le partage sous le sceau de la vérité.
Avec cette verbalisation constante des pensées, le pécheur passe des « macérations ascétiques » à une pratique d’obéissance à son maître et de renoncement de lui-même. La confession en est la mise en scène. La pénitence en sera, si l’on peut dire, le produit de sortie.
Comprendra-t-on enfin la dramatique et détestable pente que prennent les DRH qui appellent avec une naïveté déconcertante, à mettre en évidence le savoir-être des individus ! Par un mouvement délétère, engagé depuis les années 80, l’individualisation et la sollicitation de son double au travail, la subjectivité, offrent à la « science » de gestion, toutes les armes du gouvernement des hommes par leur propre vérité. Il ne reste plus aux individus qu’à s’en prendre à eux-mêmes de leurs actions et de leurs effets. C’est bien, essentiellement, dans la relation entre le « mal faire » et le dire vrai » que se constitue l’injonction de se connaître comme objet d’investigation, de procéder à son autoévaluation et de chercher son salut dans une forme de rédemption attendue… ou de payer dans sa chair le prix de ce manque de clairvoyance.
Biais et propos à l’emporte-pièce !
L’autoévaluation est donc une invite à livrer sa propre vérité dans un dispositif de gestion préorienté et assemblé autour de critères souvent opaques aux yeux des évalués et plus souvent qu’on ne le croie, des évaluateurs. Qui peut dire ce qu’il en coûte de l’aveu d’une erreur, d’une faiblesse, d’un manquement dans un univers uniquement balisé de chiffres, délais, objectifs dont personne ne semble totalement responsable. C’est le dispositif, dit-on et il a été pensé par des experts, d’où l’apparente objectivité des sanctions dont on pourrait croire qu’elles existent en toute rationalité, sans être perturbées par la subjectivité des hommes. Les vendeurs de logiciel RH ont de belles perspectives de business dès lors qu’ils désactiveront toute interférence mal venue du point de vue humain dans un process entièrement encadré par des référentiels prédéterminés !
Nous n’en sommes pas encore tout à fait là bien que, d’une certaine manière, les travaux de psychologie sociale qui ont montré et démontré l’infinité des biais (sociocognitifs, socioaffectifs) intervenants dans le jugement des hommes viennent justifier cette tendance à la mécanisation du jugement.
De façon insidieuse le basculement s’est opéré avec l’avènement de ce fameux « savoir-être » évoqué plus haut. Présenté banalement dans le triptyque paresseux : « savoir », « savoir-faire », « savoir-être » censé embrasser l’essentiel des compétences d’un individu au travail, ce dernier terme ouvre à la prolifération des points de vue sur la personnalité des sujets. Derrière la calamiteuse présentation prétendument scientifique du triptyque, et en particulier de ce « savoir-être », on a réhabilité le jugement « à la gueule du client » en rassurant l’évaluateur sur sa capacité à juger du comportement d’une personne au travail.
Chemin faisant, les titulaires de la fonction RH ont oublié de prendre en compte quelques biais bien connus en matière d’évaluation... Retenons-en quelques-uns.
Qui peut ignorer que nous nous déplaçons avec nos stéréotypes et nos préjugés et qu’à partir d’une simple trace, d’un élément mineur, nous assignons notre jugement à une ou des catégories qui sont élaborées à partir de représentations et de schémas mentaux qui vont orienter, voire déformer notre perception des choses et des personnes. Partant, la recherche et le traitement des informations se feront sur la base d’une confirmation de cette perception et les informations contradictoires seront négligées, réinterprétées ou évacuées comme non significatives.
Le plus marquant de l’époque est par ailleurs cette manie pernicieuse, mais de plus en plus tolérée (et systématiquement vendue par les traités de développement personnel) d’induire que se seraient des traits de personnalités stables et intangibles qui dicteraient les comportements et les conduites. Ce qui évacue bien entendu toute considération sur les situations, les interactions avec autrui et tous les événements externes pouvant survenir dans le réel de l’activité. La tendance lourde et abusive de ce biais de correspondance légitime les décisions les plus abruptes et parfois les plus dramatiques tout en fabriquant une fausse monnaie psychologique qui s’est insinuée dans les rouages décisionnaires des entreprises. C’est ainsi que les propos de comptoir, autrefois repoussés derrière la frontière du respect dû à autrui, ont ressurgi, ripolinés de psychologie naïve et désormais autorisés par des référentiels censés accompagner la production d’un jugement.
DRH : imposture ou naïveté ?
Il paraît que « si les DRH parviennent à convaincre les dirigeants, les salariés et l’opinion publique, ils peuvent largement contribuer à la construction d’une société plus juste et plus humaine. Beaucoup de DRH ont choisi ce métier parce qu’ils croyaient sincèrement pouvoir le faire. […] beaucoup sont pleins de bonne volonté, souvent innovants et ouverts au dialogue social ». A la bonne heure mais la démonstration reste encore à faire !
Dans notre exemple introductif, que dire en effet des motivations de la DRH à introduire l’autoévaluation ? Ne sommes-nous pas plutôt proches d’une manipulation discursive poussant encore davantage à « la servitude volontaire » des salariés ? Qu’est-ce qui empêche les directions des RH de vérifier le bien-fondé de la fonctionnalité informatique face aux besoins concrets et de réfléchir à ses effets dysfonctionnels ? C’est cette naïveté ( !) de la part des Direction des RH qui nous sidère à chaque rencontre avec un dispositif d’évaluation impensé.
Peu angéliques, certains DRH ont déchanté sans pourtant lâcher prise. Ceux-là nous confortent dans l’idée qu’il faut encore et encore déconstruire les truismes, les modes et les modèles devant lesquels s’aplatissent certains de leurs collègues sans recul critique, sans mise en perspective des effets des instruments qu’ils mettent en œuvre. Comment, sinon, expliquer qu’après tant de travaux et de démonstrations venant normalement de ce qui devrait être leur camp, les sciences sociales, ils en sont encore, par exemple à compter le nombre de niveaux à partir desquels s’effectuera l’évaluation de leurs salariés (en faut-il cinq ou six ou peut être quatre et pourquoi pas sept ?). Faut-il alors se demander s’ils sont serviles à ce point ou définitivement paresseux, faisant, cerise sur le gâteau, de plus en plus confiance aux outils informatiques pour détacher la chair de l’enjeu au prétexte de simplifier le travail du manager ?
Pour Stéphane Haeflinger, DRH écœuré des modes managériales et de leurs effets délétères, les DRH devraient réfléchir aux questions suivantes : « comment soutenir les collaborateurs afin qu’ils restent bien vivants dans l’organisation et qu’ils n’agonisent pas résignés, las et épuisés après trois années passées au même poste ? Comment développer chez les collaborateurs, dans la longue et la courte durée, de la fraîcheur, de la hauteur et de la valeur ? Enfin, comment satisfaire leur fringale d’apprentissage afin d’intégrer, naturellement de nouvelles compétences ? […] En toile de fond se pose, selon lui, l’ultime question suivante : comment in fine, humaniser davantage l’organisation du travail ? ». Il serait donc possible de penser et d’agir autrement !
S’il est vrai qu’il est plus facile, à rebours, de dénoncer la violence du travail du temps de Taylor, il faut désormais investir du temps et de l’intelligence pour dénouer la complexité du travail d’aujoud’hui, perclus de contradictions, d’incertitude et de voies multiples d’interprétation traduisant satisfaction ou insatisfaction selon les conditions, les moments et les acteurs en présence. C’est le prix à payer pour qui veut se préoccuper d’évaluation aujourd’hui. Il faudrait donc a minima que les DRH s’intéressent un peu plus au travail qu’à la gestion. Ils seraient alors sans doute moins enclins à considérer les salariés comme de simples individus en emploi ayant besoin d’être rassurés, informés, sanctionnés par des instrumentations de plus en plus sophistiquées. On les découvrirait plus engagés à s’investir dans la compréhension de la sphère du travail de ceux qu’ils sont censés accompagner et soutenir.
Si l’on place le travail au centre, on réhabilite une orientation plus conforme à la Déclaration de Philadelphie qui enjoint aux États de promouvoir « l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ». Ici, on fait le pari de la créativité des hommes et on s’efforce de construire un Droit et une économie qui leur permettent de l’exprimer.
Alors, au fond, qu’est-ce qui est alors le plus important ? Est-ce l’alignement des individus tel que le préconisent nombre de professeurs en changement qui regrettent inconsciemment le temps où on ne faisait guère de différence entre les structures et les hommes ou est-ce le développement et l’accompagnement des travailleurs, acteurs et auteurs de leur propre vie ? La ligne de fracture est précisément ici.
Notes
- Pillonel, M. & Rouiller, J., Faire appel à l’autoévaluation pour développer l’autonomie de l’apprenant, Résonances, 7, 28-31, 2002
- Deming 1986 ; Chouinard y Waldman, Dubar, Dugué, Lévy-Leboyer, Reynaud, Rogers, Miller, Matheson, Mohrman entre 1990 et 1996 ; Boussard, Clot, Courpasson, Crifo-tillet, Diaye, Estellat, Eymard-Duvernay, Greenan, Linhart, Manzoni et Barsoux, Martucelli, Levy, Segrestin, Oiry, Trepo, Williams, entre 2000 et 2004; Baudry, Dubrion, Dujarier, Ganem, Gernet, Hémard, Lallement, Léné, Reyre, Richebé,Verkindt, entre 2005 et 2011…
- J. Ardoino, G. Berger, D’une évaluation en miettes à une évaluation en actes, paris, Andsha, 1989
- Cf Aimée Moutet, Les Logiques de l’entreprise, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1997.
- In Evaluation du personnel, histoire d’une mal-posture, Éditions L’Harmattan ; Chapitre 3 « De la persistance de l’aveu et de l’examen de soi » p. 51 et sv.
- Michel Foucault, « Les techniques de soi », 1988, in Dits et écrits, Gallimard, TII, 2001, p. 1624.
- idem p.1625
- M. Foucault reprend l’exemple du moine de Cassien (Jean Cassien, Institutions cénobitiques, Edit. du Cerf, 1965, p.121) qui avait volé du pain. Dans un premier temps, le moine ne pouvait avouer. La différence entre les bonnes et les mauvaises pensées est que les mauvaises pensées ne peuvent s’exprimer facilement, le mal étant indicible et caché. Que les mauvaises pensées ne puissent pas s’exprimer sans difficulté ni sans honte empêche qu’apparaisse la différence cosmologique entre la lumière et l’obscurité, entre la verbalisation et le péché, entre le secret et le silence, entre Dieu et le diable. Dans un deuxième temps, le moine se prosterne et avoue. Ce n’est que lorsqu’il se confesse verbalement que le diable sort de lui.
- La surestimation de soi existe aussi évidemment. Pas sûr qu’elle soit mieux venue pour parvenir à une évaluation juste et équilibrée.
- F Amadieu, DRH, le livre noir, Seuil, 2013, p. 236
- Stéphane Haeflinger, DRH et manager, levez-vous !, Editions EMS, 2017.
- Ainsi notre étude de cas, l’autoévaluation informatisée ne répondait pas d’une part à des besoins (de préparation et de trace), d’autre part ne permettait pas de gagner du temps. Au contraire, cette fonctionnalité risquait d’entraver le bon déroulement de l’entretien annuel.